Conférenciers sur la Résilience
Dino Zuppa

Dino Zuppa, Ph. D., directeur général par intérim de Normes d’accessibilité Canada, supervise également l’élaboration de normes d’accessibilité fondées sur l’équité, soutenues par des recherches novatrices financées par le programme de subventions et contributions de Normes d’accessibilité Canada.
Avec plus de 25 ans de carrière, Dino a dirigé plusieurs initiatives stratégiques aux différents ordres de gouvernement au Canada, ainsi qu’au sein d’une université américaine.
Dino détient un doctorat (Ph. D.) et vit à Ottawa avec sa femme et leurs deux enfants.
Jennifer Armstrong

La Dre Jennifer Armstrong est une médecin certifiée en médecine environnementale et une experte reconnue en santé environnementale, avec plus de 25 ans d’expérience dans le traitement des patients souffrant de sensibilité chimique, fatigue chronique, fibromyalgie et allergies. Elle est la fondatrice et directrice médicale de la Clinique de santé environnementale d’Ottawa, qu’elle a créée en 1997. Aujourd’hui, sa clinique prend en charge plus de 2 000 patients et a une liste d’attente de 1 à 2 ans, ce qui témoigne de la demande croissante pour des soins spécialisés en médecine environnementale.
Une Approche Médicale Unique et Transformative
La Dre Armstrong consacre exclusivement sa pratique au traitement des patients sensibles à l’environnement et de ceux souffrant de maladies chroniques liées aux expositions environnementales. Ses méthodes thérapeutiques se sont également révélées bénéfiques pour les troubles du spectre de l’autisme, les retards de croissance, l’asthme, la dépression, le cancer et d’autres affections chroniques. L’environnement de sa clinique est entièrement sans parfum et sans produits chimiques, garantissant un espace sécurisé pour les patients souffrant de sensibilité chimique.
Forte de plus de deux décennies de pratique, la Dre Armstrong a constaté des résultats remarquables chez ses patients :
✔ Des patients qui dépendaient autrefois de médicaments conventionnels sont maintenant sans traitement, ayant appris à éviter les expositions toxiques.
✔ Des patients âgés conservent une pression artérielle normale, sans diabète ni problèmes articulaires ou musculaires, grâce aux stratégies de santé environnementale qu’ils ont adoptées.
Formation & Spécialisation
✔ B.Sc. en Biochimie – Université Carleton (1973)
✔ M.D. – Faculté de médecine de l’Université de Toronto (1977)
✔ Formation en médecine environnementale – Avec le Dr John MacLennan (1991-1994)
✔ Début de sa pratique en médecine environnementale – 1997
✔ Médecin certifiée en médecine environnementale – American Academy of Environmental Medicine (AAEM) et International Board of Environmental Medicine
✔ Présidente de l’AAEM (2008-2009)
Récompenses & Distinctions
🏆 Prix d’excellence en médecine environnementale – Canadian Society of Environmental Medicine (2003)
🏆 Nommée pour le prix Femme d’Exception – YWCA (2004)
Méthodes Thérapeutiques Innovantes
La Dre Armstrong adopte une approche holistique et fondée sur des preuves scientifiques, combinant médecine environnementale avancée et thérapies complémentaires. Ses traitements incluent :
✔ Tests d’allergie par dilutions en série
✔ Administration intraveineuse de vitamines et minéraux
✔ Sérums antiallergiques & médecine orthomoléculaire
✔ Chélation des métaux lourds
✔ Thérapie à l’oxygène
Reconnaissant l’importance d’une prise en charge multidisciplinaire, elle collabore avec des naturopathes, homéopathes, acupuncteurs et massothérapeutes, intégrant leur expertise pour favoriser la guérison et le rétablissement des patients.
Un Appel à Former Plus de Médecins en Médecine Environnementale
La Dre Armstrong milite activement pour l’intégration de plus de médecins dans le domaine de la médecine environnementale, soulignant les résultats transformateurs qu’elle a observés chez ses patients. Elle trouve son travail extrêmement gratifiant, car il permet aux patients de reprendre le contrôle de leur santé grâce à l’éducation, à la détoxification et à une meilleure compréhension de leur environnement.
Son engagement à faire progresser la médecine environnementale continue d’avoir un impact majeur sur les soins aux patients et la recherche médicale, établissant un nouveau standard pour une médecine préventive et intégrative.
Caroline Barakat

La Dre Caroline Barakat est professeure associée en santé environnementale à l’Université Ontario Tech, où elle se spécialise en épidémiologie environnementale, santé des populations et déterminants sociaux et environnementaux de la santé. Ses recherches portent sur les interactions complexes entre les expositions environnementales et la santé, avec un accent particulier sur la pollution de l’air, l’équité en santé et les trajectoires de santé au cours de la vie.
Expertise et Contributions à la Recherche
La Dre Barakat possède une vaste expérience en études longitudinales sur la santé et en recherche de grande envergure sur la santé environnementale. Ses travaux ont apporté des contributions majeures dans plusieurs domaines :
✔ Pollution de l’air et effets à long terme sur la santé – Elle a participé à une étude longitudinale de 30 ans sur l’impact de la pollution de l’air sur la santé infantile, contribuant à l’étude de cohorte des enfants de Hamilton (n=3 202, établie en 1975).
✔ Exposition environnementale et santé des populations – Elle a conçu et développé une base de données exhaustive sur les expositions environnementales pour environ 60 000 résidents des Émirats arabes unis (EAU), intégrant des données sur les comportements et les résultats de santé.
✔ Conditions neurologiques et facteurs de risque – Elle a contribué à un projet national canadien visant à examiner de manière systématique les facteurs de risque liés à l’apparition et à la progression de 14 maladies neurologiques prioritaires.
✔ Activité physique et réduction de l’exposition aux toxines – Elle a dirigé plusieurs projets financés par les Trois Conseils portant sur la participation des femmes au sport, la vie active et les stratégies de réduction de l’exposition aux toxines environnementales.
Projets de Recherche Actuels
La Dre Barakat continue de mener et de collaborer à des études interdisciplinaires abordant des enjeux clés en santé publique et en santé environnementale, notamment :
✔ Perceptions parentales sur la participation des filles au sport
✔ Développement et évaluation d’une application mobile pour réduire l’exposition aux parabènes
✔ Connaissances, perceptions et comportements des femmes face à l’exposition aux toxines provenant des produits de soins personnels et ménagers
✔ Évaluation de l’exposition des enfants à la pollution de l’air et de ses effets à long terme sur la santé
✔ Exploration des déterminants sociaux et physiques de la santé tout au long de la vie
Grâce à son expertise en épidémiologie environnementale, en pollution de l’air et en équité en santé, la Dre Barakat joue un rôle clé dans l’élaboration de stratégies et de politiques de santé publique visant à améliorer les résultats de santé au sein de diverses populations.
Paul Bérubé

Avocat et vulgarisateur, spécialiste de la gouvernance, conférencier et formateur professionnel.
Me Bérubé détient un baccalauréat en droit, Université Laval. Il est Membre du Barreau du Québec et membre honoraire du Barreau de Port-au-Prince (Haïti). Il détient des Doctorats honoris causa de deux universités situées aux Indes (Lucknow et Prayagraj). De plus, il est consultant pour la Commission des droits de la personne des Nations unies et membre de l’International Senior Lawyers Project (New York, NY).
Il a été président de Vie Autonome Canada de 1999 à 2010. Il est conférencier international sur la protection des droits des personnes en situation de handicap, les normes d’accessibilité et le leadership inclusif.
— (Japon, Corée du Sud, France, Haïti, Kenya, Afrique du Sud, Inde, El Salvador, Argentine, Sri Lanka, Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Afrique de l’Est).
Il est formateur professionnel en gouvernance et en leadership inclusif et président sortant du C. A. de Normes d’accessibilité Canada. Il est vice-président du c.a. de l’Association canadienne
Daniela Caccamo

Daniela Caccamo est professeure titulaire de biochimie clinique et de biologie moléculaire clinique à l’Université de Messine et directrice de l’unité de biochimie clinique à l’Hôpital universitaire polyclinique de Messine. Elle est titulaire d’une maîtrise en sciences biologiques et d’un doctorat en systématique bactérienne et exploitation biotechnologique de l’Université de Messine, de l’Université de Florence et du DSMZ en Allemagne.
Avec une carrière distinguée de plus de deux décennies, la Dre Caccamo a occupé divers postes académiques et cliniques, notamment celui de professeure associée à l’Université de Messine et de biologiste exécutive à l’Hôpital universitaire polyclinique. Depuis octobre 2024, elle occupe également le poste de directrice de l’École internationale de médecine de l’Université de Messine.
Ses recherches portent sur l’identification de marqueurs moléculaires pour les maladies multifactorielles, notamment les troubles neurodégénératifs, inflammatoires et liés au stress oxydatif, à l’aide d’approches expérimentales in vitro, ex vivo et d’études cas-témoins.
Nene Diallo

Nene Diallo est chercheuse à l’Association pour la santé environnementale du Québec (ASEQ). Elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’environnement de l’Université d’Ottawa, d’un diplôme en gestion de l’environnement de l’Université de Toronto et d’une maîtrise en environnement et développement durable de l’Université de Montréal. En utilisant des méthodes qualitatives, elle explore les facteurs sociaux et systémiques qui influencent l’accès à un environnement sûr et sain.
Maureen Haan

Le Conseil canadien de la réadaptation et du travail – CCRW
Maureen occupe le poste de Présidente et PDG du CCRW depuis 2012. Le CCRW est la seule organisation nationale ayant pour vision exclusive un emploi équitable et significatif pour les personnes en situation de handicap, en activité depuis 1976. Maureen apporte un éclairage sur l’emploi significatif des personnes en situation de handicap et l’engagement des employeurs grâce aux meilleures pratiques et aux résultats éprouvés du CCRW.
Maureen est active dans le secteur du handicap, notamment par son implication au sein de la société civile sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CRPD), où elle a dirigé les travaux sur l’Article 27. Elle a également joué un rôle clé dans les initiatives sur le handicap et le travail au Canada, la co-développement et la direction de la Stratégie pancanadienne sur le handicap et le travail, ainsi que son engagement en tant que membre du conseil d’administration de Normes d’accessibilité Canada et de l’Association canadienne pour l’emploi soutenu (CASE). Maureen a été nommée au Groupe consultatif ministériel sur le handicap (MDAG) au début de la pandémie de COVID-19. Parmi ses distinctions, elle a reçu le tout premier prix Hummingbird de DAWN Canada.
Maureen a débuté sa carrière au sein de la communauté des personnes sourdes et maîtrise couramment la langue des signes américaine (ASL). Elle vit à Thornhill avec son mari et ses deux fils.
Robert Lattanzio

Roberto Lattanzio est le directeur exécutif du Centre juridique pour personnes handicapées ARCH. Roberto a rejoint ARCH en tant qu’étudiant stagiaire en droit en 2003, puis a été avocat salarié jusqu’à sa nomination au poste de directeur exécutif en 2015. Il a exercé les fonctions de conseil juridique dans des litiges stratégiques à tous les niveaux de juridiction, y compris la Cour suprême du Canada, et a présenté des mémoires de réforme législative à divers niveaux de gouvernement, comités et organismes administratifs. Roberto a été nommé à de nombreux comités consultatifs et a écrit et donné des conférences sur divers sujets, notamment le droit administratif, le droit de l’éducation, le droit à l’égalité et aux droits de la personne, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les droits des personnes handicapées, la capacité et la prise de décision assistée, la réforme législative et l’aide médicale à mourir. Roberto a obtenu ses diplômes de LL.B. et de B.C.L. avec distinction de l’Université McGill en 2003. Il est le lauréat 2022 du prix Guthrie de la Fondation du droit de l’Ontario pour ses contributions à l’avancement de l’accès à la justice.
Shahir Masri

Le Dr Shahir Masri est spécialiste associé en évaluation de l’exposition à la pollution de l’air et en épidémiologie à l’Université de Californie, Irvine, où il se concentre sur la modélisation de l’exposition à la pollution de l’air ainsi que sur la communication scientifique sur le changement climatique. Outre son rôle à l’UC Irvine, il est membre auxiliaire du corps enseignant du Schmid College of Science and Technology de l’université Chapman, où il donne des cours sur la santé environnementale et la pollution, et à National University, où il donne des cours en ligne sur les sciences de premier et de deuxième cycle.
Formation et expertise
Le Dr Masri a obtenu son Doctorat en sciences (ScD) et sa Maîtrise en sciences au Département de santé environnementale de l’École de santé publique de Harvard. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’Institute of the Environment and Sustainability de l’Université de Californie, Los Angeles (UCLA).
Engagement pour le climat et sensibilisation du public
En 2018, il a fondé le projet « On the Road for Climate Action », une initiative nationale visant à sensibiliser au changement climatique par le biais d’événements éducatifs et de conférences publiques dans les 50 États américains. Son travail de vulgarisation scientifique met l’accent sur l’importance de rendre la science du climat accessible et exploitable par le grand public.
Publications et recherches
Le Dr Masri est l’auteur du livre Beyond Debate: Answers to 50 Misconceptions on Climate Change, salué par le regretté Marshall Saunders, fondateur du Citizens’ Climate Lobby, ainsi que par des scientifiques renommés du MIT, de l’UCLA et d’autres institutions. Il a également rédigé de nombreux articles d’opinion, publiés dans The Hill, le LA Times, Thrive Global, et d’autres médias.
Actuellement, ses recherches portent sur :
✔ L’exposition aux polluants atmosphériques liés à la combustion aux États-Unis et à l’international
✔ La présence de substances chimiques toxiques dans l’alimentation, les sols et les produits de consommation
Il est premier auteur de plus d’une douzaine d’études scientifiques évaluées par des pairs, publiées dans des revues académiques de premier plan. Son travail contribue à faire progresser la recherche en santé environnementale, les politiques publiques et la communication sur le changement climatique.
John Molot

Le Dr John Molot a axé sa carrière médicale sur la médecine environnementale pendant 40 ans et se consacre aujourd’hui principalement à l’éducation et à la défense de la santé environnementale. Il est le conseiller médical des associations pour la santé environnementale du Québec et du Canada (EHAQ et EHAC). Il collabore actuellement au projet Empowering Community and Removal of Barriers (ECRoB), dont l’objectif est de sensibiliser l’ensemble du Canada aux droits légaux des personnes souffrant de polysensibilité chimique et d’autres handicaps liés à l’environnement intérieur. Il a donné de nombreuses présentations éducatives aux commissions provinciales des droits de l’homme, aux barreaux, aux professionnels de la santé et aux étudiants en médecine.
En 2007, il a collaboré à l’élaboration de The Medical Perspective on Environmental Sensitivities pour la Commission canadienne des droits de la personne, ce qui a permis à la Commission de reconnaître l’hypersensibilité environnementale comme un handicap donnant droit à des aménagements. En 2013, il a rédigé le segment Perspectives académiques et cliniques d’une proposition d’analyse de rentabilité visant à créer un centre d’excellence en santé environnementale, ce qui a conduit à la création du groupe de travail de l’Ontario sur la santé environnementale (2016-18), au sein duquel le Dr Molot a été nommé par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée.
Il a récemment publié des articles évalués par des pairs sur la polysensibilité chimique, intitulés Neurological susceptibility to environmental exposures : pathophysiological mechanisms in neurodegeneration and multiple chemical sensitivity (susceptibilité neurologique aux expositions environnementales : mécanismes physiopathologiques de la neurodégénérescence et de la polysensibilité chimique) et Multiple Chemical Sensitivity (polysensibilité chimique) : Il est temps de rattraper la science. Le Dr Molot est également l’auteur d’un livre intitulé 12,000 Canaries Can’t be Wrong.
Kenichi Azuma

Le professeur Kenichi Azuma a obtenu son baccalauréat à l’Université de Kobe et a ensuite décroché un doctorat en santé environnementale à l’Université de Kyoto. Il est actuellement membre du corps professoral de la Faculté de médecine de l’Université Kindai, où ses recherches portent sur les réactions physiologiques et psychologiques des êtres humains aux facteurs environnementaux. Son expertise couvre divers domaines, notamment l’épidémiologie, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, le cancer, les maladies infectieuses, les symptômes et maladies liés aux bâtiments, la sensibilité chimique, ainsi que l’évaluation des risques sanitaires liés aux polluants environnementaux et aux agents pathogènes.
Le Prof. Azuma possède des qualifications en tant que spécialiste en santé publique et expert en santé environnementale et en médecine préventive. Il collabore activement avec des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, jouant un rôle clé dans les initiatives de santé publique à l’échelle mondiale. Il a contribué au développement des lignes directrices de l’OMS sur la qualité de l’air intérieur : polluants sélectionnés, des lignes directrices de l’OMS sur le logement et la santé, ainsi que des Monographies du CIRC sur l’identification des dangers cancérogènes pour l’Homme. De plus, il a joué un rôle essentiel dans l’élaboration des lignes directrices japonaises sur la qualité de l’air pour les environnements ambiants, intérieurs et professionnels.
Son engagement en faveur de la santé environnementale, des politiques publiques et des normes de santé mondiales témoigne de ses contributions significatives dans le domaine, faisant progresser la recherche et les politiques visant à améliorer le bien-être humain dans divers environnements.
Melissa Pagliaro

Melissa Pagliaro, CCRW
Melissa Pagliaro (ils/elle) a complété une maîtrise en psychologie judiciaire à l’Université Carleton et possède plus de cinq ans d’expérience en recherche quantitative et qualitative, ayant travaillé sur des projets à la fois universitaires et communautaires. Ils comptent également cinq années supplémentaires d’expérience en tant que consultante en réadaptation professionnelle et coach en emploi, soutenant des personnes en situation de handicap.
En tant que personne neurodivergente vivant avec de multiples handicaps, Melissa est profondément engagée dans la défense des droits des personnes handicapées, en particulier dans les domaines de l’emploi, du soutien au revenu et du logement accessible et abordable. Ils collaborent actuellement à des projets de recherche, d’évaluation et d’analyse de politiques portant sur le handicap et l’emploi pour le CCRW.
Pendant son temps libre, Melissa crée des œuvres d’art en techniques mixtes et des bijoux, joue à des jeux vidéo, et passe du temps de qualité avec ses deux chats, Misha et Locki.
Ottaviano Tapparo

Le Dr Vita Ottaviano Tapparo est un dentiste, professeur et chercheur reconnu, spécialisé en implantologie, dentisterie sans métal, thérapie laser et procédures régénératives. Avec une carrière de plus de quatre décennies, il a joué un rôle majeur dans le développement de solutions dentaires biocompatibles, de la posturologie et de nouvelles approches thérapeutiques en médecine dentaire.
Formation et Parcours Académique
Le Dr Tapparo a étudié la dentisterie à l’Université Friedrich-Alexander d’Erlangen de 1974 à 1979, obtenant son examen d’État en 1979. En 1981, il a complété son Doctorat en médecine dentaire (Dr. med. dent.). Il a ensuite poursuivi une carrière académique internationale en tant que professeur associé en implantologie dans plusieurs institutions prestigieuses :
- 1992 – Professeur associé en implantologie à l’Université de médecine et de pharmacie de Iași et à l’Université Apollonia de Iași
- 1993 – Professeur associé en implantologie à l’Université Ovidius de Constanța
- 1993-1997 – Professeur associé à l’Université de médecine et de pharmacie de Timișoara, où il a fondé et dirigé la Chaire d’implantologie, a été nommé professeur associé à vie et a introduit l’implantologie dans le programme universitaire. Il a également joué un rôle clé dans l’intégration de l’enseignement en anglais dans le système universitaire roumain.
En 1997, le Dr Tapparo a été admis à l’Académie roumaine des sciences médicales, une reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la recherche médicale et à l’enseignement.
Distinctions et Contributions à la Recherche
L’expertise du Dr Tapparo en dentisterie biocompatible et en méthodes de traitement innovantes lui a valu plusieurs distinctions académiques :
- 2003 – Professeur honoraire (Prof. h.c.) à l’Université Lucian Blaga de Sibiu
- 2014 – Professeur invité à l’Institut médical de médecine traditionnelle et non traditionnelle de Dnipropetrovsk
Domaines d’Expertise et d’Innovation
Les recherches et pratiques cliniques de pointe du Dr Tapparo se concentrent sur une dentisterie biocompatible, régénérative et minimalement invasive, en particulier pour les patients atteints de sensibilité chimique multiple (SCM) et de troubles immunotoxiques. Ses domaines d’expertise comprennent :
✔ Développement de mesures de protection pour l’élimination des métaux en dentisterie
✔ Dentisterie sans métal, testée individuellement, pour les patients atteints de SCM et immunotoxiquement fragiles
✔ Diagnostic et traitement des foyers dentaires/NICOs (ostéonécrose cavitaire neurogène) et de l’interrelation dent-organe (Auteur du livre ISBN 978-3-9817880-0-6)
✔ Thérapie laser avancée pour la santé bucco-dentaire
✔ Procédures régénératives, utilisant des facteurs de croissance autologues et des cellules souches CD 34+
✔ Implantologie sans métal, incluant le revêtement autologue des surfaces d’implants en titane et en zirconium
✔ Analyse posturologique et CMD (Dysfonctionnement Craniomandibulaire), spécialisée dans le diagnostic de la zone de rotation de la tête (atlas-axis), notamment en cas de coup violent et de troubles du nerf vague
✔ Nouvelle thérapie neurale (méthode Lamers-Tapparo), utilisant la procaïne, le NADH et les concentrés plaquettaires autologues (CGF/Concentrated Growth Factors)
Le Dr Tapparo continue d’être un pionnier dans la dentisterie biocompatible, l’implantologie et la médecine dentaire interdisciplinaire, contribuant à des approches de soins dentaires plus sûres et adaptées aux besoins des patients à travers le monde.
Adrianna Trifunovski

Adrianna Trifunovski est chercheuse à l’Association pour la santé environnementale du Québec (ASEQ). Elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences de la santé de l’Université de technologie de l’Ontario, ainsi que d’une maîtrise en sciences de la santé. En utilisant des approches mixtes en recherche, Adrianna vise à identifier l’impact de l’environnement sur la santé des populations. Elle croit fermement que chacun a le droit de vivre dans un environnement sain, exempt de toxines nocives.
Kentaro Watai
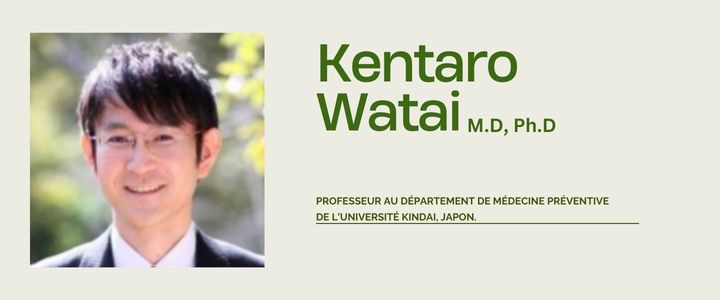
Le Dr Watai est un médecin, chercheur et enseignant spécialisé en allergologie, médecine préventive et pneumologie. Actuellement conférencier au Département de médecine préventive et des sciences du comportement de la Faculté de médecine de l’Université Kindai à Osaka, au Japon, il est également responsable du Centre d’immunologie et d’allergie à l’Hôpital général de Shonan Kamakura et chercheur invité à l’Hôpital national de Sagamihara.
Formation & Parcours Médical
Le Dr Watai a obtenu son doctorat en médecine (M.D.) à l’Université de Kumamoto en 2010, puis a complété un Ph.D. à l’Université Juntendo en 2018. Sa carrière est dédiée à l’avancement de la recherche clinique et aux soins des patients atteints de maladies allergiques et respiratoires, avec plus d’une décennie d’expérience dans des institutions médicales de premier plan au Japon.
Expérience Professionnelle
✔ 2010-2012 – Médecin résident, Hôpital national de Sagamihara
✔ 2012-2020 – Médecin spécialiste en allergologie et pneumologie, Hôpital national de Sagamihara
✔ 2020-2022 – Chef du département d’allergologie, Hôpital national de Sagamihara
✔ Depuis 2022 – Responsable, Centre d’immunologie et d’allergie, Hôpital général de Shonan Kamakura
✔ Depuis 2022 – Chercheur invité, Hôpital national de Sagamihara
✔ Depuis 2024 – Conférenciers, Département de médecine préventive et des sciences du comportement, Faculté de médecine de l’Université Kindai
Contributions à la Recherche & Domaines d’Expertise
Les recherches du Dr Watai portent sur l’allergologie, la santé respiratoire et la médecine préventive, avec des contributions majeures dans l’étude de la sensibilité chimique multiple (SCM). Ses travaux ont exploré plusieurs facteurs clés liés à la SCM, notamment :
– L’impact des expositions environnementales sur les allergies et la santé respiratoire
– Le rôle de l’historique vaccinal dans les réponses du système immunitaire- 🔬 Les altérations du microbiote intestinal associées au mode d’accouchement et leur influence sur les maladies allergiques
Le Dr Watai a dirigé des études d’association pangénomique (GWAS) et des analyses métagénomiques, contribuant à identifier les mécanismes moléculaires sous-jacents à la SCM et aux maladies allergiques. Son engagement à intégrer la pratique clinique aux avancées scientifiques continue d’influencer l’avenir de l’allergologie, de l’immunologie et de la médecine préventive au Japon et à l’international.
Susan Yousufzai

Susan Yousufzai est étudiante en médecine en troisième année à la St. George’s University School of Medicine. Elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences et d’une maîtrise en santé publique de l’Université de technologie de l’Ontario. En plus de ses études en médecine, Susan travaille comme assistante de recherche à l’Université de technologie de l’Ontario et collabore avec ASEQ-EHAQ. Ses intérêts de recherche portent sur la médecine préventive et les déterminants des comportements et des résultats liés à la santé.
Haris Theoharides MD

Le Dr Theoharides est professeur et vice-président de l’immunologie clinique et directeur de l’Institute for Neuro-Immune Medicine-Clearwater, Nova Southeastern University, FL, et professeur adjoint d’immunologie à la Tufts School of Medicine, où il a été professeur et directeur de l’immunopharmacologie moléculaire et de la découverte de médicaments, et pharmacologue clinicien à la Massachusetts Drug Formulary Commission (1983-2022). Il a siégé au conseil d’administration de l’Institut de recherche et de technologie pharmaceutiques (IFET) et au Conseil suprême de la santé du ministère de la santé en Grèce. Il est titulaire d’une licence, d’un master, d’une maîtrise, d’un doctorat et d’un doctorat en médecine, ainsi que du prix Winternitz en pathologie de l’université de Yale. Il a également obtenu un certificat en leadership mondial de la Tufts Fletcher School of Law and Diplomacy et une bourse de la Harvard Kennedy School of Government. Il a suivi une formation en médecine interne au New England Medical Center, qui lui a décerné le prix Oliver Smith « reconnaissant l’excellence, la compassion et le service ». Il a reçu à plusieurs reprises le prix Tufts Distinguished Faculty Recognition et le prix Excellence in Teaching. Il a démontré que les mastocytes, cellules immunitaires uniques des tissus, communiquent avec la microglie du cerveau et jouent un rôle essentiel dans la neuroinflammation. Ses 493 publications (49 406 citations ; h-index 113) le placent parmi les 0,05 % d’auteurs les plus cités au monde et font de lui l’expert mondial en matière de mastocytes selon ScholarGPS et Expertscape. Il a été intronisé dans la société d’honneur médicale nationale Alpha Omega Alpha, dans le Temple de la renommée des maladies rares (Rare Diseases Hall of F) et dans l’Institut de recherche sur les maladies infectieuses.
Melanie Langille MSc

Mélanie Langille est la présidente-directrice générale de NB Lung. Elle est scientifique de l’environnement, spécialisée dans l’évaluation des risques pour la santé humaine et l’évaluation de sites contaminés, avec une expertise particulière dans les contaminants en phase vapeur. Elle apporte à l’organisation une solide formation scientifique, détenant un baccalauréat en biologie et une maîtrise en sciences de l’environnement, ainsi qu’une passion pour le partage des connaissances. Son expérience antérieure en évaluation des risques, en évaluation des impacts environnementaux et en gestion de sites contaminés lui confère une perspective unique sur l’importance des déterminants environnementaux et sociaux de la santé.
Shelley Petit B.ED, M.ED

Shelley est la présidente de la Coalition des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick (NBCPD). Avant de devenir confinée à domicile en 2019 en raison d’intolérances chimiques sévères (MCS/TILT), elle était enseignante et cheffe guide depuis de nombreuses années. Elle est mère de deux filles adultes, dont l’une est autiste, ce qui lui a permis de connaître le système à la fois comme mère, comme cliente, et aujourd’hui comme défenseure. Malheureusement, Shelley est maintenant également confrontée au système en tant que patiente atteinte d’un cancer — un mélanome métastatique inopérable. Le cancer est déjà une épreuve difficile, mais lorsqu’on y ajoute le MCS, nos choix pour survivre deviennent extrêmement limités.
En tant que présidente de la NBCPD, Shelley travaille avec le conseil d’administration et les membres pour plaider en faveur de meilleures conditions pour les personnes ayant tout type de handicap — visible, invisible, physique, intellectuel, mental, environnemental, etc. Un handicap reste un handicap, et tant que nous ne travaillerons pas tous ensemble pour éliminer les barrières inéquitables imposées par la société, aucun de nous n’avancera ni ne recevra l’équité et l’égalité que nous méritons tous.
Il est grand temps d’assurer : l’accessibilité, la dignité, l’équité, l’égalité et l’inclusion pour toutes et tous, au Canada et dans le monde. Ensemble, nous avons le nombre et la force pour y parvenir.
Freda Uwa MD

Freda est une leader possédant une vaste expérience en accessibilité, en santé mentale et en gestion de projets, enrichie par son vécu personnel et son expertise professionnelle. Son leadership au sein du réseau de Vivre Autonome Canada apporte une voix forte en faveur de tous les Canadiens en situation de handicap. Ses efforts inlassables pour garantir l’accessibilité, l’inclusion et la dignité pour tous se reflètent dans son approche authentique et sa persévérance à défendre les enjeux les plus importants pour les personnes handicapées.
Ayant obtenu de nombreuses distinctions académiques, notamment des diplômes en leadership infirmier, en santé mentale communautaire et en gestion, la carrière de Freda couvre les domaines des soins de santé, de l’élaboration de politiques, de la mise en œuvre de programmes et du plaidoyer. Avec un fort engagement envers les droits des personnes handicapées, les normes d’accessibilité et l’équité, Freda est consultante en droits de la personne auprès de l’Institut de diplomatie de Washington et membre à vie du World Women Leaders Network. Elle se consacre à l’autonomisation des individus et des organisations pour favoriser un changement significatif.
Au-delà de son travail professionnel, Freda est passionnée par le mentorat, l’impact social et la promotion de communautés inclusives. Elle est également une professionnelle accomplie du métier de cuisinière, certifiée par le Sceau rouge canadien, et elle adore offrir de bons repas aux gens!
Audrey Grant PhD

Audrey Grant est professeure adjointe au département d’anesthésiologie. Elle a mis à profit son expertise en épidémiologie génétique et en génomique statistique pour l’étude des traits et maladies immunologiques, et plus récemment, de la douleur, en particulier le développement de la douleur chronique. Actuellement, son laboratoire mène des études d’association pangénomique en utilisant de vastes bases de données cliniques publiques, notamment la UK Biobank (UKB) et l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Elle applique des approches classiques ainsi que de nouvelles méthodes d’apprentissage automatique pour combiner les statistiques de test GWAS avec des données issues d’autres sources d’expression tissulaire ou d’épigénétique, dans une optique de génomique intégrative visant à caractériser l’architecture génétique des phénotypes de douleur et à distinguer les composantes étiologiques environnementales des composantes génétiques. L’objectif est de tirer de nouveaux enseignements sur les implications physiopathologiques de l’architecture génétique sous-jacente, en vue d’interventions cliniques futures.
Bill Adair

William Adair possède une vaste expérience en leadership professionnel et communautaire dans les domaines de la santé et du handicap. Sa carrière dans les secteurs à but non lucratif et public se distingue par un leadership collaboratif et fondé sur des principes, qui inspire toutes les personnes impliquées à atteindre des résultats extraordinaires.
M. Adair a été directeur national des services aux patients à la Société canadienne du cancer pendant 13 ans, où il a élaboré un plan stratégique visant à coordonner les efforts de lutte contre le cancer à travers le Canada. Il a été le premier directeur général de Wellspring, un centre de soutien psychosocial à Toronto pour les personnes atteintes du cancer. Il a participé à un panel international chargé d’évaluer les cinq premières années du programme « L’Europe contre le cancer ». Il a également occupé le poste de PDG de Lésion médullaire Ontario pendant 23 ans, faisant passer son budget de 2 millions à plus de 10 millions de dollars au cours de son mandat.
M. Adair est actuellement directeur général de Lésion médullaire Canada, une fédération axée sur les consommateurs qui aide les personnes ayant une lésion médullaire ou d’autres handicaps physiques à atteindre l’autonomie, l’indépendance et une participation communautaire pleine et entière.
Il est membre fondateur de l’Alliance canadienne des politiques en matière de handicap, de la Fondation ontarienne de neurotraumatologie, de Candlelighters Canada et de l’Hospice Dorothy Ley.
Plus récemment, M. Adair a mis son leadership et son expertise au service du gouvernement du Canada à travers plusieurs initiatives : le Projet canadien pour l’accès et l’inclusion, l’Alliance pour la législation fédérale sur l’accessibilité, le Groupe de travail sur les formats alternatifs, le groupe consultatif de la Commission canadienne des droits de la personne concernant le respect de la CDPH et de son protocole facultatif, ainsi que le Comité consultatif sur l’accessibilité de la Cité parlementaire. Il a également dirigé le comité chargé de formuler des recommandations pour la politique de communication accessible du gouvernement du Canada. Il est membre du conseil d’administration de Normes d’accessibilité Canada. Il fait également partie du Groupe consultatif sur les handicaps dirigé par la ministre canadienne responsable de l’inclusion des personnes handicapées.
M. Adair est titulaire d’un baccalauréat ès sciences de l’Université du Minnesota et est diplômé du cours de leadership exécutif sur la gestion des organisations à but non lucratif de l’Université Harvard. Il a reçu la Médaille du service méritoire du gouvernement du Canada en 2016.
Gail M. Eyssen MD

La Dre McKeown-Eyssen a obtenu son doctorat en épidémiologie à l’Université McGill de Montréal en 1975. En tant que professeure adjointe au département d’épidémiologie et de biostatistique jusqu’en 1979, elle a participé à des études sur la santé au travail, notamment sur les effets sur la santé de l’exposition à l’amiante et à l’exposition au méthylmercure dans le nord du Québec.
Elle a joint l’Université de Toronto en 1979 et a pris sa retraite de l’École de santé publique Dalla Lana en 2009. Là-bas, ses recherches principales portaient sur la relation entre l’alimentation et le cancer du côlon et d’autres tumeurs solides, ainsi que sur les mécanismes biologiques impliqués. Grâce à une nomination conjointe au Département des sciences de la nutrition, elle a également collaboré à des études sur les facteurs alimentaires associés au diabète.
Son intérêt pour la sensibilité chimique multiple a commencé en 1989 lorsqu’elle a été invitée par le ministère de la Santé de l’Ontario à joindre le Comité consultatif du ministre sur l’hypersensibilité environnementale, où elle a siégé jusqu’en 1992. Elle a été membre du Conseil consultatif de recherche clinique sur l’hypersensibilité environnementale pour le ministère de la Santé de l’Ontario de 1992 à 2000 et membre du Comité consultatif sur les hypersensibilités environnementales pour le Laboratoire de lutte contre la maladie, Santé Canada de 1998 à 2001. Elle a été la chercheure principale de l’unité de recherche sur l’hypersensibilité environnementale financée par le ministère de la Santé de l’Ontario de 1993 à 1998. Avec ses collègues, elle a élaboré un questionnaire reproductible pour évaluer toutes les caractéristiques de la SCM qui avaient été incluses dans les sept définitions de cas alors en vigueur et a identifié celles qui étaient les plus à même de faire la distinction entre les patients les plus et les moins susceptibles d’être atteints de SCM. En utilisant la définition de cas optimale, le groupe a étudié plusieurs hypothèses biologiques dans une série d’études cas-témoins et a identifié plusieurs gènes associés à la SCM.
